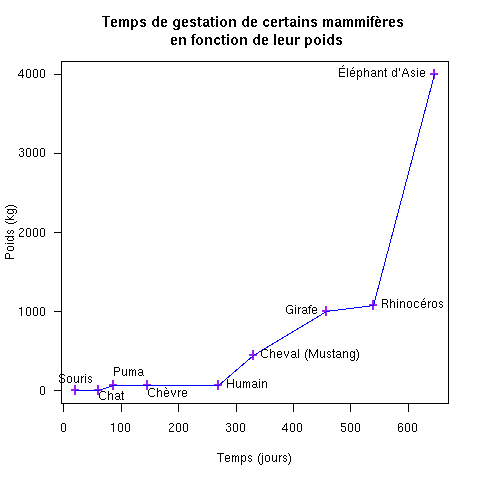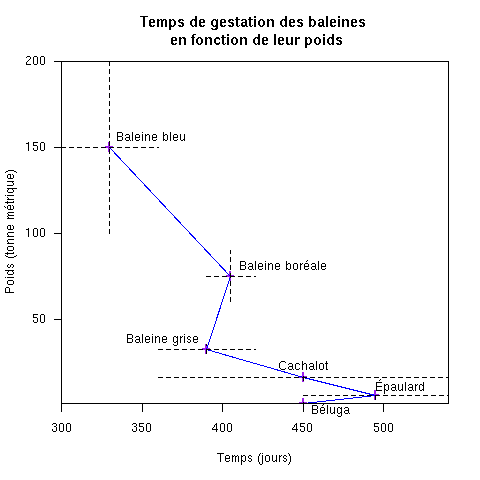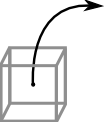Comment fonctionne AdWords
ptaff.ca héberge une page où l'on vend des autocollants à l'effigie de de Tux, ce valeureux manchot symbole du système d'exploitation GNU/Linux. Tentant d'augmenter les ventes (en dépit de l'opinion de mon webmestre favori), je suis allé visiter le système de publicité AdWords de Google.
Le principe est simple: on achète des mots-clefs et lorsqu'un usager exécute une recherche sur ce mot-clef, la publicité apparaît à gauche de l'écran sous le titre « Sponsored Links » ou encore « Liens commerciaux » sur la version française du site. Par exemple, lorsque l'on effectue une recherche avec le mot-clef "voiture", on peut apercevoir la publicité de Volkswagen avec la courte description « Découvrez ses 120 innovations.
À partir de seulement 29 950 $. ». À chaque fois qu'un usager clique sur l'hyperlien de cette page, Volkswagen paie une somme d'argent X à google. Si on tape un mot en plus du mot-clef acheté, notre publicité n'apparaît pas. Voir les liens commandités pour la recherche pour "voiture libre" par exemple.
Bien, mais comment sont fixés les prix? Voilà une question intéressante à laquelle je n'ai pu trouver de réponse satisfaisante sur le site de Google. J'ai du en faire moi-même l'expérience.
Premièrement, chaque campagne a un coût d'activation qui dépend du pays où vous êtes. Une campagne consiste en une description (2 lignes d'un maximum de 35 caractères chacune) et un hyperlien. Pour le Canada, il en coûte 10 $CAN pour activer une campagne. On fixe également un coût maximum que l'on est prêt à payer à chaque jour, histoire de ne pas être endetté de 10 000$ si tout le monde se mets à cliquer sur notre publicité. Une fois le plafond atteint, la publicité n'apparaît plus pour le reste de la journée. J'ai choisi un plafond de 5$/jour.
Une fois le compte activé - il suffit d'une carte de crédit - il ne reste qu'à sélectionner des mots-clefs. Le montant initial des mots-clefs est minime. Par exemple j'ai acheté le mot « tux » pour 7¢, « linux sticker » et « wikipedia » pour 14¢ chacun. On a ensuite un tableau qui fait un résumé du nombre de gens qui ont vu la publicité, le nombre de gens qui ont cliqué et donc le montant d'argent qui sera prélevé sur ma carte de crédit.
« wikipedia » est un mot-clef bien choisi. Des milliers de gens font cette recherche à chaque jour, je l'ai constaté sur la page de description de ma campagne. Je croyais donc avoir un filon. Sauf que.
Le lendemain, j'ai essayé d'acheter différentes combinaisons de mots-clefs avec « wikipedia » et aucun de mes essais ne coûtait moins de 1.40$… Là je me suis dit que c'était une attrape, que Google laissait aller les premiers mots-clefs pour pas cher et que par la suite, ils chargeaient le total pour ajouter des mots-clefs. J'étais dans l'erreur. En fait, dans les heures qui ont suivis, mes mots-clefs (tux, linux sticker, wikipedia) ont tous été désactivés et je devais accepter de débourser plus de 1$ pour chaque usager cliquant sur le lien si je voulais les réactiver…
J'en déduis la chose suivante. Si l'on veut avoir de la publicité dans AdWords, il faut soit débourser un montant énorme pour chaque personne cliquant sur le lien (de l'ordre du dollar) ou il faut qu'un tas de gens sélectionnent ce lien. Ça a 2 effets. Premièrement, des petits joueurs comme moi sont exclus de ce genre de publicité, je ne fais pas assez d'argent à chaque vente d'autocollant pour me permettre de participer à un tel système. Deuxièmement, il faut que les requêtes soient pertinentes par rapport à la publicité pour que les gens visitent le site, sinon le prix par visiteur ne fait qu'augmenter, décourageant ainsi les éventuels polluposteurs. C'est pourquoi il y a si peu de liens commerciaux, c'est parce que les prix sont fixés de telle sorte qu'il faut que ce soit rentable en svp si l'on veut placer de la pub.
Google a donc, grâce à ce système, tenté de calquer la réalité matérielle en faisant en sorte que la publicité non rentable devienne dispendieuse, alors qu'il pourrait simplement mettre de la publicité pour n'importe quel mot-clef et attendre que plusieurs clients décident de l'acheter, créant ainsi une compétition et faisant monter les prix seulement à partir de ce système. Ils font d'ailleurs déjà monter les prix entre les différents participant, en plus du système expliqué ci-haut.
En conclusion, ça m'a coûté environ 12$ et j'ai appris pourquoi il y a si peu de publicité sur Google!
 3 commentaires
3 commentaires